

Cette page comprend :
Qques réponses édifiantes, une feuille de perso classique,remarques spécifiques, personnages types ainsi qu'une version diminuée de
La page des règles de combat les quelles me conviennent assez et dont l'auteur est Mathieu Mazzoni (au format html avec qques ch'tites modifs à venir ou déjà faites)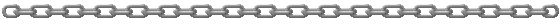
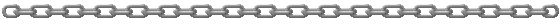
A t-on vraiment besoin de garder les pièces de bronze en plus de cellesd'argent et d'or ?J'avais pris qques repères de valeur pas exactement bien pensés proportionnellement : un oeuf 3/4 p.bronze, repas dans une auberge modeste :2/5 p.argent, salaire journalier moyen d'un militiin dans un quartier modeste(petite bourgeoisie / commerçant) : 1 p.or...à près, il faut échelonner les prix en fonction de la rareté des matières premières, la qualité de la conception ou du service, la quantité de demandes,... ce à quoi on rajoute des modificateurs d'affinitées client / vendeur, delocalisation, d'heure (on voit mal un boulanger être réveillé pour une miche de pain de seigle à minuit pour ne baguette de pain sauf excellentes relations et/ou grasse rémunération...),...
Un classement intéressant de la vente de ces objets / services serait un classement par type d'échoppe ou de service.
Toutes ces boutiques sont + ou - rares et officielles et n'existent pasforcément à la surface, les gouris sont qd même en tantinet civilisés ... et puisque qu'ils ne sont pas les bienvenus à la surface, autant construire leur bonn petit (petit ? !) chez soi, sous terre...).
Dans l'ordre approximatif (très) des boutiques visitées par les PJs (quelque soit le rang (pauvre, modeste, riche) et que ce soit dans la légalité ou non (marché noir/contrebande...) :
le magazin d'objets magiques (il
ne doit pas en exister d'officiel, surtout pas !! C le moteur au
bourrinisme), l'armurerie, le bazar, l'auberge (de préf avec
chambres sures, animation musicale, organisation de
combats/paris, jeux divers,préseneces de belles courtisanes...),
le troquet, le relai de courrier(livraison d'un message/missive,
location d'un cheval), l'écurie (location ouachat d'un cheval),
carosse/calèche (bon C pas trop une boutique, mais les services
proposés sont parfois plutôt nomades, alors bon...) ,
l'herboristerie,le temple/l'église, les maisons closes
(prostitution et alcools forts), docteurs/médecin/maison de
soin..., les salons de thé, les clubs de discussion,les
serruriers, les ateliers de bricolage de tous genres (objet sur
demande etdescription précise), les drogueries (tabacs, poisons,
drogues,...), librairie/bibliothèque,
papeterie/relieur/scribes..., orfèvrerie/bijouterie, animalerie,
théatre, devin/chiromancin/..., particulier/université de
magie, particuliers ou guildes d'assassin, de garde du corps,
d'informateurs/espio!ns, de contrebande, de voleurs, de brutes,
de magiciens... mais aussi lesécoles, le cordonnier, la
laiterie, l'épicerie, la boulangerie, le charcutier,le
poissonier, le traiteur, le couture/vente de vêtements/costumes
divers, confiseur marchand en articles de pèche, produits
chimiques, fruits et légume (euh... G un doute sur ce que sont
vraiment les produits maraichers... qqu'un peut me renseigner),
armateurs/navires/bateleurs/boucaniers, entrepôts de
marchandise, viticulteur/marchand de vin, cirque, draperie,
marchands d'objets d'art/artistes sculteurs/peintres/poêtes/jongleurs/dresseurs... et autres balladins de tous poils /musiciens /marchands d'instruments de
musiques/poterie, euh... guèpier ..., caserne/poste de garde,
prison,orticulteur, botaniste, décorateur, femme de ménage, marché d'esclaves, arène, ...................
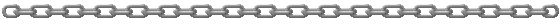
dit aussi le Noble Dé Chu
Prend un malin plaisir à ridiculiser les gens
Captive les foule par ces discours en particulier quand il s’agit de tourner en dérision des faits ou une attitude (+2 en discours )
Très théâtral, il ne peut s’empêcher d’adjoindre à son discours, habillements et gestuelles, intervention du public et de compagnons.
Rêve de monter une troupe de troubadours dénonçant de part leur spectacle et de manière très détournée les dessous de tables inavouables et inavoués de l’aristocratie Umélorienne et des autres personnes se prétendant injustement nobles.
C’est un noble dessein pour lui que de dénoncer toutes ces injustices et actes indignes du rang de la noblesse.
Il remet sans cesse en question les raisons des privilèges dont bénéficie la noblesse en se prenant comme exemple (pourquoi ne serait moi même noble si l’on accepte à la cour princière des individus tels que ce…. qui ….).
Né de parents Nobles suite à une aventure amoureuse d’un soir sans lendemain, son père ne l’a jamais reconnu ( il ne sait même pas qui est son père et le recherche d’ailleurs). Quant à sa mère, elle l’a abandonné, jeune bébé constituant un fardeau trop lourd à porter pour son amour propre et son statut de noble Dame à la cour.
A pour habitude de s’habiller en noble mal fagoté accroissant ainsi l’aspect théâtral captivant qui le caratérise.
Caractéristiques | |||
| Adresse: 11 | Agilité: 8 | Beauté: 10 | Courage: 16 |
| Elocution: 20 | Endurance: 11 | Force: 11 | Mémoire: 13 |
| Morale: 15 | Perception: 10 | Rapidité: 12 | Initiative:3 |
| Le métier de voleur | |||
| Camouflage: 5 | Crochetage: 5 | Discrétion: 4 | Dissimulation: 5 |
| Escamotage: 6 | Filature: 5 | Repérage: 5 | |
| Relations humaines | |||
| Baratin: 12 | Comédie: 16 | Déguisement: 14 | Discours: 20 |
| Etiquette: 14 | Intimidation: 8 | Jeu: 5 | Marchandage: 10 |
| Séduction: 9 | |||
| Prouesses physiques | |||
| Acrobatie: 10 | Contorsion: 4 | Course: 13 | Escalade: 4 |
| Nage: 5 | |||
| Combat | |||
| Arme à 2 mains: 5 | Arme d'hast: 5 | Bouclier: 5 | Epée: 5 |
| Fléau: 5 | Hache & Masses: 5 | Poignard: 5 | Dague: 5 |
| Fléchettes: 5 | Hachette: 5 | Javelot: 5 | Armure: 5 |
| Esquive: 6 | Arbalète: 5 | Arc: 5 | Lance-pierres: 5 |
| Fronde: 5 | Pugilat: 5 | ||
| Recherches & développement | |||
| Bricolage: 5 | Chimie: 6 | Co (Commerce): 9 | Co (Politique): 14 |
| Co (Loi): 10 | Dressage: 5 | Evaluation: 5 | Falsification: 5 |
| Premiers secours: 6 | |||
Fatigue: 16
ØØØØØØØØØØØØØØØØOOOOOOOOOOOOOOO
Santé: 16 ØØØØØØØØØØØØØØØØOOOOOOOOOOOOOOO
Equipement : tout une garde de robe de nobles + habit
marchand, et pauvre et autres costumes de divers acabit.
Un stylet, un monocle et une canne de bois finement ouvragée mais sur laquelle sont gravés des scènes telles qu’un noble demandant à un prévôt qu’il demande à un préfet qu’il demande à un milicien qu’il demande à un vulgaire voleur de lui ramener une fille de joie le plus discrètement du monde afin qu’il puisse assouvir ses instincts lubriques avant de poursuivre sa difficile vie de parasite du peuple passant ses journées à se plaindre, se moquer et à dépenser l’argent que le petit peuple (pour rester poli) gagne à force de dur labeur…
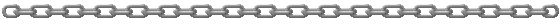
Etant donné que l'atlas de Bejofa a été abandonné par ces auteurs (il semblerait)...
Je vous le met en ligne afin que que vous puissiez en profiter et me proposer des modifs possibles.
Cet Atlas est l'oeuvre de Letorve (sans les images, tableaux et autres... C le site tel que qqu'un la posté sur la m.l.)
N'hésitez pas à lui faire parvenir toutes vos remarques, critiques et suggestions. Elles seront les bienvenues pour pouvoir fignoler ce projet.
Seulement, je n'ai pas (moi, Geoff.), l'adresse e-mail ou le site de ce cher Letorve.
Alors si jamais qqu'un passe par là ou que Letorve lui même visite cette page, qu'il me contacte mailto:hylst@caramail.com ..
Bejofa et son relief
Ancienne partie de Samarande, Bejofa a été construite dans la même logique, à savoir d'une position dominante de façon à prévoir l'arrivée d'éventuels envahisseurs. D'ailleurs, comme sa sœur voisine, Bejofa dispose à ses hauteurs d'une enceinte, de la même importance que l'enceinte du Prince à Samarande. Légèrement moins haute toutefois, la colline de Bejofa n'atteint que les 90 mètres (en altitude absolue, sinon c'est 60 mètres au-dessus du Sahar). Par contre, ses versants subissent une forte déclivité. Cette pente est en particulier très forte sur les versants sud et nord de la colline. Comparée à Samarande, ces pentes n'ont pas permis la construction de grandes demeures car l'espace est plus limité et surtout le relief plus abrupt.
Hormis cette enceinte, Bejofa ne possède pas d'autres reliefs importants. En fait, la ville est construite sur les versants nord, est et ouest. Toutefois, d'autres reliefs mais cependant beaucoup plus faibles (en particulier au nord-est) contribuent à donner à Bejofa, à l'instar de sa consœur, un aspect vallonné.
En ce qui concerne les berges du Sahar, le relief est le même que sur l'autre rive. En amont, le fleuve est particulièrement resserré et Bejofa n'échappe aux inondations et donc aux indispensables constructions sur pilotis. En aval, le fleuve est à l'inverse très large et permettait au port de Bejofa le transit de navires importants de part le passé. Aujourd'hui, ils sont loin d'égaler la taille et le nombre de ceux passant par Samarande.
Enfin, l'est de Bejofa ne s'étend pas aussi loin que sa consœur et donc les derniers quartiers sont établis avant les premières falaises calcaires, hautes de 30 mètres.
La ville
Introduction
Au contraire de Samarande, Bejofa (en tant que ville) n'a pas subit de transformations importantes. En effet son "apparition" remonte à 2476, or la Principauté n'a pas souffert de guerre ou de catastrophes depuis cette date. Toutefois, Bejofa en tant que quartier a toujours été associé à l'histoire de Samarande. Ainsi, la fameuse révolte des Bandeaux Noirs ainsi que l'insurrection de 2258 ont débuté dans ce quartier.
Concernant donc l'histoire de Bejofa avant qu'elle ne devienne une Cité à part entière, il convient de se reporter à l'histoire de Samarande. De ce fait, Bejofa est âgée de plus de 2500 ans, même si son apparence a complètement changé depuis.
Le nom de Bejofa vient de celui de son plus grand quartier, surnommé Bej de nos jours.
Les remparts
Tout comme Samarande, Bejofa possède deux lignes de fortifications. Elles ont d'ailleurs été construites au même moment. La première et la plus ancienne est l'enceinte du Gouverneur, elle date de la même époque que l'enceinte du Prince à Samarande, même si son nom lui n'a changé qu'en 2476. La seconde enceinte est plus récente (trois siècles) et fut construite en même temps que celle de Samarande et pour les mêmes raisons, à savoir se protéger d'une éventuelle menace héloderme.
L'enceinte du Gouverneur : Cette enceinte isole le centre de Bejofa. Autrefois, elle indiquait les limites de la ville, mais celles-ci ont été finalement étendues avec le rattachement des faubourgs. Maintenant, ces remparts n'ont plus de signification militaire mais plutôt sociale.
Côté villes, les constructions touchent les remparts alors que de l'autre côté, les constructions sont bien plus harmonieuses et espacées. Dans une ville réputée dangereuse, cette enceinte représente un havre de paix et de ce fait il est sévèrement gardé. Les entrées y sont réglementées et surveillées encore plus que dans l'enceinte similaire de Samarande. La nuit, les portes sont tout simplement fermées.
L'enceinte extérieure : aussi appelée Grande enceinte, elle fut construite à la même époque que celle de Samarande (aux environs de 2300) sur l'initiative du gouverneur de cette dernière. Les raisons invoquées étaient de protéger les faubourgs autours des enceintes centrales. Lorsque Kalaar tomba aux mains des hélodermes dix ans plus tard la construction de ces remparts n'était pas achevée. La panique et les problèmes rencontrées alors ont été décris dans l'Atlas de Samarande. Bejofa n'a pas échappé à la règle et ainsi certains quartiers n'ont pas pu financer leur "portion de rempart" qui devait les protéger.
De nos jours, seuls six quartiers sont à l'extérieur de l'enceinte. Ce faible nombre s'explique d'une part par la faible étendu de la Cité par rapport à sa voisine, et d'autre part par sa faible expansion économique. Il faut comprendre que Bejofa a toujours eut des moyens très réduits et n'a donc pas pu se permettre la construction d'extensions.
L'enceinte militaire est toujours utile même si toutes menaces d'invasions ou de conflits semblent pour le moment lointaines. Cependant, son entretien s'est dramatiquement réduit. Haute de dix mètres et large de six, elle n'est pour ainsi dire pas du tout entretenue. Même son fossé a fini par se remplir de terre, de mauvaises herbes et de déchets divers. Toujours surveillée, il y a bien longtemps que le zèle de ses gardes a disparu. D'ailleurs, les portes et pont-levis n'ont pas été fermés depuis des années.
Les portes de la ville
Bejofa compte 10 portes dont seulement six, percées dans la Grande Enceinte, donnent sur l'extérieur. Les quatre autres sont en effet percées dans l'enceinte du Gouverneur.
Les portes de l'enceinte du Gouverneur : cette enceinte compte donc quatre portes. Même si elles ont perdu leur aspect militaire d'autrefois, elles restent fortement gardées. Leur rôle est de limiter l'accès aux riches quartiers des sections I et II. Elles disposent d'une herse très bien entretenue, abaissée chaque nuit et relevée au matin. Enfin, de lourds battants de bois renforcé, hauts de trois mètres, ouvrent sur un passage étroit, jute large pour la circulation d'un chariot.
Par mesure de sécurité, les portes de l'enceinte du Gouverneur sont fermées entre 22 et 6 heures, et ce en toutes saisons. Il est cependant possible de se les faire ouvrir en montrant toutes les garanties nécessaires et en signant un registre. Jours et nuits, 20 hommes d'armes et un officier montent la garde à chaque porte ; la relève a lieu toutes les six heures.
Les portes de l'enceinte du Gouverneur sont désignées par le nom des rues qu'elles enjambent.
Les portes de la Grande enceinte : l'enceinte extérieure compte six portes. Ce sont d'impressionnants ouvrages militaires. Elles ne sont toutefois plus gardées depuis maintenant quelques années. Les herses ainsi que les lourds battants hauts de cinq mètres ne sont pour ainsi dire plus entretenus. Les portes s'ouvrent sur un passage suffisamment large pour permettre à deux chariots de se croiser. Par ailleurs, chaque porte donne, vers l'extérieur, sur un pont de pierre ou un pont-levis qui enjambe le fossé qui borde l'enceinte. Ce dernier est lui aussi laissé à l'abandon. De la terre, des ronces, des mauvaises herbes et des déchets ont recouvert les parois et diminué sa profondeur.
Les portes de l'enceinte extérieure ne sont plus fermées. Jadis elles étaient encore fermées la nuit et surveillées nuit et jour, mais depuis que Bejofa s'est dégradé, cette surveillance est devenue totalement accessoire.
D'ouest en est, les portes de la Grande enceinte sont les suivantes : la Porte des Ombres, le Portique, la Porte du Nord, la Porte du marcheur, la Porte des condamnés et la Porte brisée.
La porte qui ouvre sur le quartier 3 (section II) est la Porte des Ombres. Elle doit son nom au quartier au quartier sur lequel elle donne. Ce quartier misérable et quasiment désert, est d'une réputation on ne peut plus sinistre. De cette porte part une route en direction de l'ouest.
La porte qui ouvre sur le quartier 10 (section III) est le Portique. Ce nom provient du fait de la petite taille de ce passage. Pendant longtemps, les paysans et certains commerçants se sont plains de l'étroitesse de cette porte qui empêche l'entrée aux trop volumineux chariots.
La porte qui ouvre sur les quartiers 12 et 13 (section III) est la Porte du Nord. Elle doit tout simplement son nom à son orientation géographique.
La porte qui ouvre sur le quartier 24 (section IV) est la Porte du Marcheur. Cette entrée portait jadis un autre nom, lorsque la route menant aux villages et fermes voisines était encore praticable. Depuis quelques années, elle est laissée à l'abandon et n'est plus utilisée que par des voyageurs à pieds ou à cheval. Les Bejofards ont donc surnommé cette porte ainsi.
La porte qui ouvre sur le quartier 30 (section IV) est la Porte des condamnés. Elle doit son nom à l'existence d'un bagne dans le quartier 29. Or, souvent les prisonniers sont emmenés à l'extérieur de la ville pour y travailler dans les champs. De cette porte part une route en direction de l'est.
Enfin, la porte qui ouvre sur le quartier 35 (section V) est la Porte brisée. Elle doit son état de délabrement avancé. Cette porte ne peut plus être fermée, elle est devenue un simple passage.
Les routes
Trois routes quittent Bejofa, mais seules deux sont encore utilisables. Ces deux routes sont pavées sur toute la longueur des rues qui les prolongent dans Bejofa, constituant ainsi des artères principales.
Ces routes ne sont que de larges pistes de terre battue ; elles mènent aux bourgs environnants.
Les sections
Bejofa est administrativement divisée en 5 sections. Chaque section est plus ou moins grande et compte un nombre variable de quartiers. Les quartiers d'une même section peuvent être très différents : plus ou moins riches, plus ou moins sûrs, plus ou moins salubres, etc. La plupart des sections sont cependant peu fréquentables (sections II, IV et V).
Tout comme à Samarande, une section est sous l'autorité d'un prévôt. Pour maintenir l'ordre, un prévôt est assisté de dix préfets de jour et dix préfets de nuit. Selon la taille de la section, donc, l'ordre est plus ou moins bien maintenu selon que le nombre des préfets y proportionnellement important. Enfin, à superficie égale, deux sections seront plus ou moins populeuses selon la richesse de leurs quartiers.
Chaque section porte un numéro (de I à V). Mais les Bejofards préfèrent nommer une section d'après l'un de ses bâtiments ou quartiers célèbres. Par exemple, on parle plus volontiers de la section de Bej (nom du quartier 26) que de la section IV ; ainsi, une même section peut avoir plusieurs noms usuels. D'ailleurs, les frontières des sections sont souvent floues dans l'esprit des Bejofards ; elles ne sont après tout que des subdivisions administratives et théoriques.
Section I : elle comprend les quartiers 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. C'est la section la plus huppée de Bejofa. Les neufs quartiers qui la composent sont soit luxueux (8 et 16), soit riches (17, 18, 19, et 20) soit modestes. C'est là que se pressent l'aristocratie et la bourgeoisie de Bejofa.
Section II : elle comprend les quartiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est sans conteste la section la plus mal famée. Ses quartiers sont soit misérables (2, 3 et 5) soit pauvres (4 et 6). Le quartier 1 est rural ; on y pratique une maigre agriculture. Les quartiers 1 et 2 sont des quartiers extérieurs.
Section III : elle comprend les quartiers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22 et 23. Avec la section I, cette section est la seule de Bejofa où il fait encore bon vivre. Elle est composée de quartiers modestes (9, 10, 12, 13, et 22), d'un quartier riche (14) et de quartiers pauvres. Le quartier 11 est situé à l'extérieur de la ville.
Section IV : elle comprend les quartiers 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. C'est une section très mal cotée, qui accueille une population très démunie. Ses quartiers sont tous pauvres, exceptés les quartiers 28 et 29 qui sont misérables, et le quartier 25 qui est rural. Les quartiers 25 et 29 sont des quartiers extérieurs.
Section V : elle comprend les quartiers 32, 33, 34, 35, 37 et 38. Cette section relativement mal cotée, comprend quatre types de quartiers. On y trouve en effet, des quartiers pauvres (les quartiers 32 et 33), modestes (les quartiers 34 et 35), un quartier misérable (le quartier 37), ainsi qu'un quartier rural (le quartier 38). Les quartiers 37 et 38 sont des quartiers extérieurs.
Les juridictions prévôtales : chaque section est elle-même subdivisée en deux à trois juridictions prévôtales (voir La justice page XX et suivantes). Une juridiction prévôtale est un découpage administratif qui correspond au territoire sur lequel officie un prévôt. La plupart des Bejofards ignorent le tracé des juridictions prévôtales.
Section Population
I 75 000 II 85 000 III 105 000 IV 70 000 V 60 000
La section I comprend deux juridictions prévôtales : la première s'étend sur les quartiers 7, 8, 15 et 16 ; la seconde s'étend sur les quartiers 17, 18, 19, 20 et 21. La section II comprend deux juridictions prévôtales : la première s'étend sur les quartiers 1, 2 et 3 ; la seconde s'étend sur les quartiers 4, 5 et 6. La section III comprend trois juridictions prévô-tales : la première s'étend sur les quartiers 9, 10 et 14 ; la deuxième s'étend sur les quartiers 11, 12 et 13 ; la troisième s'étend sur les quartiers 22 et 23. La section IV comprend trois juridictions prévôtales : la première s'étend sur les quartiers 24, 25 et 26 ; la deuxième s'étend sur les quartiers 27, 28 et 29 ; la troisième s'étend sur les quartiers 30 et 31. La section V comprend deux juridictions prévôtales : la première s'étend sur les quartiers 32, 33 et 34 ; la seconde s'étend sur les quartiers 35, 37 et 38.
Le quartier franc : un quartier n'appartient à aucune section. Le quartier 36 est en effet un "quartier franc". Il n'appartient pas administrativement à Bejofa. Ce quartier est une terre d'église. Entre autres particularismes, ce quartier est hors de la juridiction de la prévôté bejofarde, mais est néanmoins responsable du maintien de l'ordre et du respect des lois de la Cité.
Les quartiers
Si les sections sont avant tout une réalité administrative, les quartiers n'ont rien de théorique. Ils sont représentés par les plus petites subdivisions de la carte (voir page XX). Bejofa compte ainsi 38 quartiers. Par commodité, un numéro a été attribué à chacun d'eux (de 1 à 38), mais les Bejofards les désignent par des noms. Le nom d'un quartier peut être inspiré par une rue, un bâtiment, une activité, un événement historique, etc. Le quartier des Ombres (3), par exemple, doit son nom à la présence d'esprits morts-vivants qui y rodent ; le quartier 15 est le quartier des Marches en raison de son nombre important d'escaliers.
Lorsque nous ferrons allusion à un quartier, nous donnerons son nom s'il y a lieu, mais indiquerons toujours son numéro (en chiffres arabes) et, éventuellement, celui de sa section (en chiffres romains). Exemple : quartier des Ombres (3, I)
Sauf exception, tous les quartiers de Bejofa appartiennent à l'une des catégories suivantes :
Rural : cela peut sembler étrange, mais tout comme Samarande, Bejofa accueille quelques quartiers ruraux. C'est à dire qu'on y fait de l'élevage et, surtout, des cultures. Les gens y vivent dans des fermes, y ont des moulins, des granges, etc. La densité de population y est naturellement très faible. Rares sont les paysans propriétaires ; la plupart sont des métayers exploitant les terres d'aristocrates ou de grands bourgeois. Les quartiers ruraux sont peu nombreux mais vastes : ils occupent environs 9 % de la superficie de Bejofa. Ils sont consacrés à l'élevage mais surtout à l'agriculture. Ainsi la ville complète la production de sa voisine ; Sa-marande privilégiant l'élevage.
Misérable : ces quartiers représentent 16 % de la superficie de Bejofa. La population y est extrêmement démunie. Les plus basses couches sociales y tentent de survivre dans l'illégalité. La densité de population y est hélas très forte, quoique légèrement inférieure à celle des quartiers pauvres. Les rues ne sont ni pavées ni éclairées, les rares bâtiments sont en bois ou à l'état de ruines et les notions d'hygiènes et de salubrité sont totalement absentes. Les épidémies, incendies, crimes, et trafics illicites y sont fréquents. A cela s'ajoute parfois une population bien plus dangereuse, com-posée de morts-vivants et d'esprits en maraude.
Pauvre : les quartiers pauvres sont les plus nombreux à Bejofa ; ils constituent environs 30 % des quartiers. Ce sont des quartiers populaires où la qualité de vie est à peine supérieure à celle des quartiers misérables ; il n'y fait pas bon vivre. La densité de population y est très forte. Les rues n'y sont pas pavées, les bâtiments de pierre y sont rares, les eaux d'évacuation passent au milieu de la chaussée. Les quartiers pauvres sont , selon les critères de l'époque, au-dessus du seuil de salubrité mais vous ne voudriez pas y vivre. Les épidémies et incendies n'y sont pas fréquents mais n'étonnent personne.
Modeste : Les quartiers modestes occupent à peu près 26 % de la superficie de la ville. Ce sont des quartiers populaires, où la densité de population est assez forte. Certaines rues sont pavées, les maisons ont des fondations solides, les bâtiments sont en pierre pour les étages inférieurs et en pierre pour les étages supérieurs. Il fait bon y vivre ; l'essentiel de la classe moyenne y habite. La plupart des rues marchandes sont situées dans les quartiers modestes.
Riche : les quartiers riches sont réservés à l'élite ; ils composent environs 14 % de la superficie de Bejofa. Ce sont avant tout des quartiers résidentiels, où vivent, nobles et grands bourgeois. Les maisons individuelles côtoient les hôtels particuliers. Les rues y sont non seulement pavées, mais gardées (en particulier à la nuit tombée). On y trouve quelques commerces et le siège des grandes guildes marchandes.
Luxueux : les quartiers luxueux sont réservés à l'élite de l'élite, bref au gratin de Bejofa. Les quartiers luxueux s'étendent sur 5 %.de la superficie de la ville. Seuls les membres de la plus haute noblesse et de la meilleure bourgeoisie y vivent. Ici, les maisons particulières font figure de taudis ; les hôtels particuliers sont la norme et l'on trouve quelques propriétés magnifiques, avec parcs et jardins. Les quartiers luxueux se transforment en forteresse dès la nuit tombée.
La répartition des quartiers bejofards est la suivante :
Quartiers ruraux : 1, 25 et 38.
Quartiers misérables : 2, 3, 5, 28, 29 et 37.
Quartiers pauvres : 4, 6 11, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32 et 33.
Quartiers modestes : 7, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 34, 35 et 36.
Quartiers riches : 14, 17, 18, 19 et 20.
Quartiers luxueux : 8 et 16.
Les quartiers sont inégalement populeux. Les nantis vivant plus à leur aise, la population des quartiers luxueux est riches est moins dense. Le tableau suivant indique la superficie occupée par chaque catégorie de quartiers et, en vis-à-vis, le pourcentage de population qui y vit, le nombre (approximatif) d'habitants correspondant et les classes sociales représentées. Pour connaître le détail des classes sociales, reportez-vous au chapitre La population (page XX et suivantes).
Quartiers Superficie Population Habitants Classes sociales
Ruraux 9 % 2 % 7 900 Plèbe
Misérables 16 % 16 % 63 200 Plèbe
Pauvres 30 % 36 % 142 200 Plèbe
Modestes 26 % 40 % 158 000 Petite bourgeoise et plèbe
Riches 14 % 5 % 19 750 Aristocratie et haute bourgeoisie
Luxueux 5 % 1 % 3 950 Aristocratie et haute bourgeoisie
On voit donc comment l'aristocratie et la bourgeoisie (soit 7 % de la population) vivent sur 19 % de la superficie de la ville. A l'inverse, les quartiers pauvres (46 % de la superficie) accueillent la moitié des Bejofards. En outre, l'élite sociale (aristocratie et haute bourgeoisie) ne se mêle jamais aux autres catégories de populations.
Grosso modo, les données précédentes signifient que, en moyenne :
- un quartier rural compte 2 600 habitants.
- un quartier misérable compte 10 500 habitants.
- un quartier pauvre compte 12 900 habitants.
- un quarter modeste compte 14 300 habitants.
- un quartier riche compte 3 700 habitants.
- un quartier luxueux compte 1 900 habitants.
Il ne s'agit là que d'une règle générale, deux quartiers appartenant à la même catégorie pouvant s'étendre sur des superficies très différentes. Ainsi, les quartiers 7 et 10 sont tous deux des quartiers modestes mais le premier est beaucoup moins grand que le second ; sa population est probablement deux fois inférieure à la normale tandis que celle du quartier 10 est probablement supérieure d'un tiers à la normale.
N.B. : les quartiers riches et luxueux sont essentiellement des quartiers résidentiels. Tandis que les commerces (boutiques et marchés) sont plutôt situés dans les quartiers modestes.
Les habitations
Les habitations des Bejofards varient grandement selon les quartiers et, donc, selon le train de vie de leurs occupants. Tel riche bourgeois vit dans un superbe hôtel particulier, tandis qu'un modeste commerçant doit s'entasser avec sa nombreuse famille dans un deux pièces. Les différents types d'habitations que l'on peut grossièrement distinguer à Bejofa sont au nombre de quatre : les propriétés, les hôtels particuliers, les maisons et les masures.
Les propriétés : elles consistent en général en une ma-gnifique demeure principale plantée au milieu d'un grand jardin. Dans une ville surpeuplée comme Bejofa, quel luxe inouï représente un propriété. De fait, les propriétés sont réservées à l'élite de l'élite, très peu représentée à Bejofa. On n'en trouve que dans les quartiers luxueux, et elles sont environs au nombre d'une dizaine. Toutes les propriétés comptent au moins une dépendance ; certaines ont des ménageries, des écuries, etc. Une propriété est toujours ceinte d'un mur et évidemment, extrêmement protégée.
Les hôtels particuliers : un hôtel particulier est une riche demeure de pierre, haute de trois ou quatre étages, bâtie en retrait de la rue. De part et d'autre du corps principal partent deux ailes qui encadrent une cour. Sur la rue, la cour intérieure est fermée par un mur ou, pour les hôtels les plus luxueux, par un autre corps de bâtiment que rejoignent les deux ailes. On accède à la cour par une porte cochère. Les hôtels particuliers sont habités par l'aristocratie et la meilleure bourgeoisie.
Les maisons : elles sont bâties directement sur la rue. L'usage de la pierre est rare ; il est signe de richesse. Une maison compte entre 1 et 5 étages ; elle ouvre parfois sur une arrière-cour commune, parfois sur une jardin de quelques ares. Selon les quartiers, les maisons sont larges et spacieuses, ou hautes et étroites. L'urbanisation sauvage qui est de règle dans les quartiers pauvres fait que les maisons s'y imbriquent selon un plan compliqué ; ailleurs, la disposition des maisons est plus rigoureuse. Les maisons sont souvent divisées en appartement ; un appartement compte une à plusieurs pièces et peut s'étendre sur tout un étage.
Les masures : une masure est une maison misérable. Il peut s'agir d'une maison en ruine, laissée à l'abandon et devenue insalubre ; il peut également s'agir d'une simple cabane de fortune construite au fond d'une cour ou d'un terrain vague, d'un réduit aménagé, d'une grange à moitié effondrée, etc. Naturellement, les masures sont le refuge des plus démunis. Bejofa compte hélas un nombre important de masures.
Les différentes habitations que nous venons de décrire ne se trouvent pas dans les mêmes proportions dans tous les quartiers. Le tableau suivant vous indique la proportion de chaque type d'habitation par catégorie de quartiers (voir Les quartiers, page 5).
Quartier Propriétés Hôtels Maisons Masures
Luxueux 20 % 65 % 15 % 0 %
Riche 0 % 75 % 25 % 0 %
Modeste 0 % 5 % 80 % 15 %
Pauvre 0 % 0 % 60 % 40 %
Misérable 0 % 0 % 20 % 80 %
Enfin, pour savoir qui habite où, consultez ce dernier tableau. Pour connaître le détail des catégories sociales, consultez le chapitre consacré à la population (page XX).
Habitation Catégorie(s) sociale(s)
Propriété Aristocratie, haute bourgeoisie
Hôtel particulier Aristocratie, haute bourgeoisie
Maison Petite bourgeoisie, plèbe
Masure Plèbe
Les rues
La largeur, le tracé et la propreté des rues de Bejofa sont très variables. En fait, tout dépend des quartiers traversés. Les rues sont sinueuse et sombres dans les quartiers populaires, elles sont droites et aérées dans les quartiers aisés. Pour connaître le tracé d'une rue ou d'une ruelle, le mieux est encore que vous consultiez le plan du quartier. Sinon, consultez les paragraphes suivants en tenant compte de la richesse des quartiers concernés.
Propreté : sauf dans les quartiers riches ou luxueux, les rues ne sont jamais propres. Pourquoi ? D'abord par défaut de pavage (voir plus loin). Mais surtout parce que de même qu'à Samarande, l'usage veut que l'on utilise les rues comme dépotoir, comme égout ou comme fosse d'aisance. Il est habituel en effet chez les Bejofards, de vider ses poubelles ou ses pots de chambre par la fenêtre. Outre que cette coutume rend la vie des piétons assez compliquée, cela contribue à transformer la chaussée en un cloaque. Ajoutez à cela les déjections des animaux, la paille répandue devenue fumier, et vous comprendrez pourquoi les élites préfèrent traverser la ville en carrosse ou en chaise à porteurs. Les gens ne sont pas plus propres dans les quartiers aisés, mais ils ont au moins les moyens de faire nettoyer les rues.
Pavage : les rues ne sont jamais pavées dans les quartiers pauvres et misérables. Parfois, on peut trouver des reste de pavés, du temps où le quartier était plus aisé ; les pavés des rues ont depuis servi à construire de précaires abris. Le sol est donc partout en terre battue. Les rues sans pavage sont donc poussiéreuses par temps chaud et sec, boueuses par temps humide, voire franchement marécageuses dans les régions inondables (voir Les catastrophes, page XX). Dans les autres quartiers, les pourcentage de rues pavées sont les suivants : 20 % dans les quartiers modestes, 50 % dans les quartiers riches et 90 % dans les quartiers luxueux. Ces pourcentages peuvent paraître faible à un contemporain. Pourtant, le pavage reste un luxe ; il est entièrement à la charge des quartiers. Même dans les quartiers luxueux, certaines ruelles ont encore un sol en terre battue.
Eclairage : peut être encore plus que le pavage, l'éclairage public est un luxe ; il est à la charge des quartiers ou des particuliers. Il est en général assuré par des torches ou des lanternes suspendues. Dans les quartiers luxueux, 60 % des rues sont éclairées la nuit ; dans les quartiers riches, moins de 40 % des rues le sont, et 5 % dans les quartiers modestes. Dans les quartiers pauvres et misérables, l'éclairage public n'existe pas. En revanche, un décret oblige les aubergistes, taverniers et autres gérants d'établissements à éclairer le pas de leur porte. Ce décret est assez respecté dans les quartiers modestes mais reste ignoré de la plupart des quartiers pauvres et de la majorité des quartiers misérables. De fait, une bonne partie de Bejofa est plongée dans le noir dès la nuit tombée. Il est hasardeux de s'y promener sans lanterne et imprudent, pour ne pas dire suicidaire, de s'y promener sans escorte.
Quartiers Pavage Eclairage
Misérables 0 % 0 %
Pauvres 0 % 0 %
Modestes 20 % 5 %
Riches 50 % 40 %
Luxueux 90 % 60 %
Les quartiers ruraux méritent d'être considérés à part. En effet, on peut difficilement parler de rues ou de ruelles les concernant. En règle générale, les quartiers ruraux sont aussi propres, pavés et éclairés que la campagne peut l'être. C'est